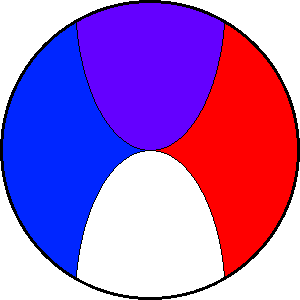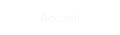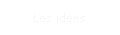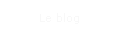09 : mort, euthanasie, suicide
Quidam :
La façon de considérer la vie est effectivement très variable d'un individu à l'autre.
PG :
Tout comme la façon de considérer la mort d'ailleurs. Il est bien regrettable que ceux qui sont si prompts à la dispenser soient généralement si peu disposés à la recevoir. C'est pour le moins contradictoire.
Quidam :
Peut-on les blâmer ? Tout le monde a peur de la mort.
PG :
Ah non, pas tout le monde. Cela dépend des convictions de chacun.
La façon de l'aborder peut être très différente d'un individu à l'autre, allant de la terreur du néant ou, pire, du purgatoire éternel, à la confiance sereine en un après radieux et rassurant. Car cette question est partie intégrante du questionnement existentiel le plus basique : quel est le but de l'existence ici-bas ? Selon que votre réponse personnelle est de vous préparer d'une façon ou d'une autre à une après-vie plutôt que de vivre carpe diem au jour le jour sans vous préoccuper d'un éventuel après, vous appréhenderez forcément la vie différemment. Et vous aborderez alors aussi la mort différemment.
Inversement, la façon dont vous considèrerez la mort aura un gros impact sur votre existence. Beaucoup de gens n'osent pas vivre par peur. La peur du regard des autres est une puissante force de stagnation mais n'est basée que sur la vanité et le manque de confiance en soi. La peur de l'inconnu est autrement plus conséquente. Sa forme la plus exacerbée est justement la peur de la mort, c'est-à-dire la peur que le changement apporte la fin de l'existence, ce qui nous semble alors pouvoir être la fin de tout puisque c'est tout ce que nous connaissons. Dès lors, apprivoiser l'idée de la mort permet de se débarrasser de cette peur. Et on vivra d'autant mieux qu'on sera en paix avec la mort. La crainte de la mort enchaîne, tandis que la dépasser libère.
Quidam :
Mais c'est là une préoccupation très intime. A-t-elle vraiment sa place dans une discussion visant à refaire la société ?
PG :
Partant du principe que la société a pour objectif de répondre aux aspirations de ses citoyens, ce que vous pourrez en attendre sera très différent selon qu'elle répondra au souhait de vivre plutôt qu'à celui de ne pas mourir.
Quidam :
C'est quand même assez proche d'être la même chose, non ?
PG :
Pas pour moi en tout cas. La survie suffit pour ne pas mourir. Mais, comme disait mon lieutenant-instructeur de préparation militaire, « la survie n'est pas la vie ». La survie, ce ne sont que les deux premiers niveaux de la pyramide de Maslow. La vie, c'est toute la pyramide. La survie répond tout juste aux besoins de base des animaux. Alors vous pensez bien que ce ne sera aucunement le cas pour les besoins supérieurs d'un humain.
Actuellement, notre société est régie par ce principe de repousser la mort et nous véhiculons dans notre culture le conditionnent de la craindre, comme si c'était la chose la plus terrible qui soit. Et de nombreuses mesures liberticides sont d'ailleurs prises au nom d'une intention sécuritaire excessive, cherchant à éviter quelques éventuels morts supplémentaires par an. Mais est-ce que ça en vaut toujours le coup ? Et le coût ? Le frein mis aux aspirations de vivre et d'expérimenter n'est-il pas bien plus contreproductif que quelques décès de plus chaque année ? Personnellement, quand on me dit « il est interdit de faire ça, c'est pour votre sécurité », je vois rouge. Elle a bon dos la sécurité. Qu'on me prévienne du danger, oui, qu'on me l'interdise, non ! C'est ma liberté que de choisir d'expérimenter le danger. Par contre, la contrepartie est évidemment la responsabilisation des gens vis-à-vis de leurs actes inconsidérés, notamment par le fait que la société n'ait pas à prendre en charge les conséquences de tout et n'importe quoi. Il faut bien conserver un minimum de sélection naturelle…
Quidam :
Ce qui m'amène à dire qu'un peu de peur de la mort, ça aide aussi à vivre… en nous incitant à rester en vie justement.
PG :
Il est clair que se libérer de la crainte de la mort ne doit pas devenir un moteur d'imprudence et d'inconséquence. Notamment parce que l'imprudence aura plus vite fait de vous mener dans une chaise roulante que dans un cercueil. Ici comme partout, il faut une juste mesure. Mais actuellement, nous sommes dans un extrême qu'il faut réajuster.
La logique actuelle est : « dans le doute, abstiens-toi ». Et c'est exactement pourquoi les gens se sclérosent à cette idée, se brident et ne vivent plus pleinement. D'autres disent plutôt : « quand vous êtes dans le doute, faites un pas de plus pour améliorer votre perspective ». C'est un principe assez radicalement différent, non ?
Quidam :
Effectivement. Mais chacun a sa propre attitude face au risque et donc face au doute. Certains s'abstiennent, d'autres explorent. Cela relève tant du caractère personnel que de l'héritage culturel, voire cultuel. « Il faut de tout pour faire un monde », dit-on. Et c'est pourquoi, je reste un peu sceptique quant à l'intérêt pour la société de s'emparer du débat.
PG :
Les croyances et l'attitude face à l'inconnu sont effectivement affaire personnelle, mais la société a à traiter des effets de ces croyances et attitudes au sujet de la mort. Et ainsi que je le disais, l'un de ces effets est de dissuader les citoyens d'oser vivre pleinement. Quand ce n'est pas directement la société qui impose ce bridage par des mesures sécuritaires excessives. Une société qui a pour vocation de favoriser le bonheur de ses membres ne peut s'en satisfaire, parce qu'il est très difficile pour eux d'espérer répondre à leur besoin de réalisation en vivant avec le frein à main tiré. Elle se doit donc de stimuler le débat et la réflexion sur ce sujet, non pour apporter une solution toute faite mais pour que chacun trouve la sienne. Et de préférence pour que cette solution en soit une qui aide l'individu à vivre plutôt que de l'en empêcher.
Alors il y a essentiellement deux façons de considérer la mort. Pour le matérialiste, qui croit que la vie est la résultante d'une coïncidence fortuite d'agencement de molécules ayant constitué des acides aminés, qui eux-mêmes se sont par hasard assemblés pour former le premier organisme unicellulaire, cet Adam amibien dont toute vie découlerait et dont nous descendrions tous si l'on en croit la théorie évolutionniste dérivant des travaux de Charles Darwin, forcément, il ne peut y avoir de vie en dehors du corps, donc pas de survivance de l'être après la mort. La mort est donc la fin. Ca peut effrayer, effectivement, et on peut comprendre la tendance à vouloir repousser au maximum cette échéance. En même temps, cela devrait amener l'individu à s'interroger sur l'intérêt même de cet intermède entre naissance et mort, si c'est pour qu'il n'en reste rien après son décès. La vie, hasard biochimique, éphémère et sans lendemain. Si c'est aussi insignifiant que ça, quelle logique y a-t-il, sauf tendance masochiste, à s'accrocher à cette existence dès lors qu'elle est porteuse, passé un certain âge, de souffrances sans perspective d'amélioration plutôt que de joies et de réalisations ? Je ne trouve que des contradictions dans les théories matérialistes, mais à chacun ses convictions. Si ces tentatives d'explications avancées par des scientifiques peuvent, malgré les immenses failles irrésolues qui les minent, suffisamment rassurer certains face à l'inconnu pour les inciter à réaliser au moins une partie de leur potentiel d'être humain, alors c'est une bonne croyance pour eux.
Je ne m'étendrais pas sur les théories de panspermie selon lesquelles la vie sur Terre proviendrait d'un ensemencement venant de l'espace, que ce soit via des êtres unicellulaires ou des humanoïdes, car elles ne font que repousser la question de l'origine de la vie au niveau extra-planétaire.
Par contre, au matérialisme pur et dur, basé sur un très improbable hasard, s'opposera la croyance d'une création par une intelligence supérieure, divine, dans un dessein spécifique. Cela regroupe de nombreuses variantes, comme par exemple expliquer l'apparition de l'amibe primordiale en remplaçant simplement le hasard par une volonté divine. Il se murmure d'ailleurs qu'Einstein aurait dit : « le hasard est le nom que prend Dieu pour voyager incognito ». J'ignore si ce sont là des paroles du vieil Albert tant certains semblent prompts à lui en prêter de nombreuses dans l'espoir que ça leur donne plus de poids, mais cela importe bien moins que la citation elle-même qui conserve toute sa valeur quel qu'en soit l'auteur.
A l'autre extrémité de la palette des théories relevant de cette catégorie du dessein intelligent se trouve le créationnisme ex nihilo le plus absolu par claquement de doigt. Cette création, qu'elle soit par claquement de doigt ou par lente évolution dirigée, peut d'ailleurs se limiter à une œuvre purement matérielle d'un dieu créateur adepte des trains électriques et assimilés, et où la mort du corps signifierait, pour nous humains, la fin de l'être. On retomberait alors, à toutes fins pratiques pour ce débat, sur le cas matérialiste. Mais en général, est associé à cette création un côté occulte, âme, esprit, ou les deux, qui survit au corps, celui-ci n'étant que le véhicule physique d'une conscience immatérielle. Dès lors, la mort n'est pas la fin, mais le simple passage d'un état d'existence à un autre. Alors dans cette logique de vie continue, pourquoi s'accrocher à une existence de misère et de souffrance, dès lors que l'espoir de jours meilleurs est passé ? Pour que celui qui croit au purgatoire et se pense grand pécheur devant l'Eternel puisse repousser un peu une damnation également éternelle ? Qu'est- ce que quelques années de plus ou de moins face à l'éternité ? Curieusement, ceux qui se pensent justes et destinés au paradis tendent à s'accrocher de la même façon à leur vie terrestre. Pourquoi ? Est-ce uniquement par abnégation, pour donner un débouché professionnel à tous ces gens employés dans les mouroirs de la société ?
Quidam :
Là, clairement, vous parlez d'euthanasie.
PG :
Je parle d'abord de l'acharnement thérapeutique.
Sous prétexte de chercher à repousser la mort, la société crée des situations bien plus dramatiques. Maintenir dans la souffrance des gens en phase terminale de maladies incurables a-t-il une logique ? Que ce soit dans une optique matérialiste de néant post-mortem ou dans une optique spiritualiste d'une vie après la vie, une survie dans la souffrance peut-elle être préférable à l'apaisement de la mort ?
Jusqu'à quel point faut-il aller contre la nature, et, ce faisant, contre le bien-être d'un individu ? Par défaut, la société prône l'acharnement thérapeutique, le jusqu'au- boutisme médical, quitte à maintenir un corps à l'état de légume des années durant. Parce que la mort fait peur et que la société n'incite pas ses membres à la regarder en face pour se mettre en paix avec elle. Et aussi, il faut bien le dire, parce que certains intérêts économiques s'enrichissent grâce à cet état d'esprit. Car tout cela à un coût, qui est très lourd, qui pèse sur tous, et qui est loin d'être perdu pour tout le monde.
Quidam :
Enfin, vous ne pouvez quand même pas ramener ces questions de vie humaine à des considérations financières !
PG :
Je regrette, mais la question financière fait partie du problème. L'argent utilisé pour maintenir dans une survie misérable des gens qui ne le souhaitent peut-être pas tant que ça, pourrait aussi être utilisé pour améliorer les conditions de vie d'autres personnes. Toute décision d'allocation de ressources limitées a un coût d'opportunité.
Vous-même, est-ce que vous sacrifiez systématiquement vos vacances en donnant quelques milliers d'euros chaque fois que quelqu'un fait une quête pour permettre une transplantation cardiaque au profit d'un enfant financièrement défavorisé ? Non ? Alors trêve d'hypocrisies. Vous aussi vous comptabilisez le prix de la vie humaine. Et vous aussi vous considérez le coût de l'opportunité. Dans le cas de la société, lorsque les soins sont pris en charge par la collectivité, ces coûts vous sont transparents. Mais c'est bien vous qui payez tout ça. Avec vos impôts, vos taxes, vos cotisations. Et c'est transparent uniquement parce que vous ne voyez pas tout ce qui aurait pu être fait avec ces ressources détournées vers ces utilisations peu constructives.
Pourquoi la société, dans sa quête d'optimisation de l'utilisation des ressources communes, devrait-elle donner la préférence à faire perdurer la souffrance des survivants plutôt qu'à investir dans le bien-être des vivants ? Parce que ça vous rassure ? Parce que l'acceptation de la mort n'est pas intégrée dans notre philosophie de vie ? Il faut cesser cette lâcheté. « Laissez les morts enterrer les morts » a dit Jésus voici fort fort longtemps au royaume de fort fort lointain. N'est-ce pas justement pour inciter les vivants à s'occuper de vivre plutôt qu'à se mortifier ? La société résulte de nos choix, qui eux-mêmes sont dictés par nos valeurs. Avons-nous, collectivement, les bonnes valeurs ?
Quidam :
Alors ces gens qui se réveillent après des années de coma, vous les sacrifieriez ?
PG :
D'abord, je parle de l'acharnement thérapeutique qui maintient dans la souffrance. Le comateux n'est pas en souffrance. Je ne dirai pas qu'il est inconscient puisque nombre de témoignages attestent que c'est parfois le contraire, mais il n'est pas maintenu sur le gril comme peut l'être une personne en phase terminale de cancer, que d'ailleurs on rend souvent semi-inconsciente par diverses drogues histoire d'atténuer ses douleurs.
Mais il y a un moment où effectivement doit se poser la question de la limite jusqu'à laquelle la collectivité peut accepter de prendre en charge un comateux longue durée avant de le débrancher. Evidemment, ici comme souvent, la perspective individuelle s'oppose à la perspective collective. Et il est très difficile, voire impossible vu la limitation actuelle de nos consciences, de savoir, au cas par cas, quelle est la bonne décision. Pourtant la collectivité a aussi l'obligation de gérer les grands nombres. Pour un qui va se réveiller au bout de trente ans, combien ne se réveillent jamais ? Si les cas de comateux longue durée sont rares, le coût est facilement assumable par les ressources collectives. Il n'y a pas alors de problème et on peut accepter de donner du temps au temps avant de trancher la question de la probabilité du réveil ou pas du comateux. Mais si les cas devenaient trop nombreux, le problème pourrait commencer à se poser. Les comas de longue durée sont toutefois heureusement relativement peu fréquents. Par contre, il n'y a qu'à voir, dans les comptes de la sécurité sociale, le coût des traitements palliatifs de cancéreux incurables en phase terminale, parfois mis en coma artificiel, pour se rendre compte que nous avons largement franchi le seuil où cela pose problème. Car pendant qu'on se ruine pour prolonger leurs souffrances de quelques semaines, les budgets manquent pour l'enseignement, la justice, la police, et j'en passe. Notre société fait-elle les bons choix ? On peut s'interroger.
Vous mentionniez tout à l'heure la question de l'euthanasie. Il y a une nuance à prendre en compte. L'euthanasie fait référence à la décision de mettre volontairement un terme à une situation de souffrance sans espoir d'un individu. C'est une décision qui doit appartenir à chacun, du moins tant que son état de conscience le lui permet, et avec laquelle la société ne doit avoir aucun droit d'interférer. Contrairement à ce qu'elle fait encore actuellement, même si la notion du droit à l'euthanasie, donc du droit à disposer de sa mort, le droit à mourir dans la dignité, fait lentement son chemin. La question de limiter l'acharnement thérapeutique est différente. Il ne s'agit pas là de mettre volontairement fin à une vie, mais d'arrêter, certes volontairement, de l'entretenir artificiellement. L'euthanasie offre la mort comme une libération, l'acharnement thérapeutique cherche à repousser une mort inéluctable.
Quidam :
Et vous appliqueriez le même raisonnement aux gens qui sont à l'état de légume sans être malade, sauf à considérer l'extrême vieillesse comme une maladie ?
PG :
Pourquoi ferais-je une différence ? Le facteur clé est l'existence ou pas d'un espoir raisonnable d'amélioration. On peut débattre sans fin de ce terme « raisonnable », tant il existe parfois des rémissions quasi miraculeuses de maladies considérées incurables, mais admettons cette notion sans chercher à la quantifier. Une personne très âgée qui a besoin d'un respirateur artificiel, de dialyse, de soins contre les escarres, d'alimentation par perfusion, d'aides-soignants pour la nettoyer, y compris lorsqu'elle fait ses besoins dans son lit, est-elle réellement en vie ou seulement maintenue dans un état de survie très artificielle ? Existe-t-il un espoir « raisonnable » que son état s'améliore ? Clairement pas. Alors il faut savoir poser une limite. Et ce d'autant plus que ce n'est pas un cas isolé, mais un cas fréquent qui pèse lourdement sur toute la société, au détriment des autres vivants.
Quidam :
Justement, où la situez-vous cette limite ?
PG :
Il y a plusieurs choses à prendre en compte. La frontière à partir de laquelle se pose la question de l'euthanasie se situe au seuil de la capacité à s'assumer pour les petits gestes quotidiens. L'existence humaine commence avec la satisfaction du premier niveau de besoin, les besoins physiologiques. Mais on peut distinguer dans ce niveau ce qui relève du fait d'avoir à manger pour que le corps soit nourri, de ce qui relève du simple fait de pouvoir porter cette nourriture à sa bouche. Si vous ne pouvez vous procurer à manger, la société peut y suppléer au titre de la solidarité. Mais si vous ne pouvez même pas manger tout seul, vous laver, faire vos besoins proprement, bref que même au niveau le plus basique vous ne pouvez prendre soin de votre corps par vous-mêmes, certes la société peut aussi aider, mais la question de savoir si vous êtes réellement en situation de vivre se pose. L'acharnement d'assistanat est assimilable dans le raisonnement à l'acharnement thérapeutique. C'est juste qu'une assistance humaine tient le rôle des appareils médicaux vitaux.
Les limitations d'une société qui n'incite pas ses membres à se mettre en paix avec la question de la mort éclatent ici au grand jour. Autrefois, mais peut-être encore un peu aujourd'hui, dans certaines tribus amérindiennes, la mort était considérée comme faisant partie du cycle naturel de la vie dont ce n'est qu'une péripétie. Dès lors elle ne faisait pas peur et était acceptée. Les personnes âgées, lorsqu'elles ne se considéraient plus en état de s'assumer, de vivre dignement, partaient seules dans la forêt à la rencontre de leur mort. Elles vivaient leur existence pleinement le temps qu'il leur était possible de le faire, puis partaient dans la dignité pour « la dernière chasse », sans peser ni dégrader la vie des autres par une dépendance sans espoir. Bien sûr, j'ai conscience que c'est là une présentation caricaturale de ce principe et qu'il n'est jamais facile pour la personne concernée de prendre la décision, comme l'illustre fort bien le film « la ballade de Narayama » qui traite de ce même sujet mais au Japon. Car où se situe le seuil à partir duquel la vie digne devient impossible ? Et puis pourquoi pas un jour de plus, etc. Vous connaissez probablement l'histoire de la grenouille plongée dans de l'eau tiède qu'on chauffe progressivement et qui ne s'aperçoit que trop tard qu'elle a passé le seuil au-delà duquel elle n'est plus capable de s'en extraire. Mais une fois ce seuil passé, quelle estime de soi peut-on ressentir à survivre dans la dépendance ?
Et se pose alors l'autre question : comment apprécier l'existence si la perspective encouragée par la société est celle d'une fin aussi misérable ?
Quidam :
La question semble légitime. Mais il en est une autre qui l'est également : est-il digne pour une société de se débarrasser ainsi de ses vieux, comme on se débarrasse de poids morts, sans considération pour tout ce qu'ils ont fait dans le passé, notamment pour en assurer la pérennité et la peupler ?
PG :
Difficile de se départir de cette culpabilité. Jusqu'où doit-on assistance à ses parents sous prétexte qu'ils nous ont torchés lorsque nous étions petits ? Leur devons- nous à un certain moment de sacrifier notre propre vie à nous occuper de la leur ? Chacun a sa propre réponse, en fonction de sa capacité d'abnégation et de dévouement. Mais aussi selon ses aspirations, ses moyens, et avec une forte influence de la qualité de la relation humaine qu'il a entretenue avec ses parents. On se dévouera plus facilement pour des parents aimants que pour des parents indignes, méchants, alcooliques, violents, voire pédophiles. Notre société actuelle considère que ça importe peu et que par défaut les enfants ont une obligation de prise en charge des parents, ne serait-ce que financièrement. Je n'adhère nullement à cette position. Car il faut aussi pousser le raisonnement un peu plus loin. Ne pourrait-on reprocher à certains parents de faire des enfants par intérêt, avec investissement éducatif minimum, juste pour disposer de quelqu'un qui s'occupe d'eux lorsqu'ils deviennent vieux, leur évitant de devoir prendre des décisions fatidiques ? La culpabilisation peut aussi fonctionner dans ce sens.
Je suis pour que les gens soient responsables d'eux-mêmes, et que les relations humaines soient librement consenties. Je suis donc contre le fait que la prise en charge financière de la dépendance d'une personne âgée puisse retomber sur ses enfants contre leur gré. Et je suis pour que la personne qui n'est plus en capacité de s'assumer dans son existence quotidienne soit incitée à s'interroger sur l'utilité de s'accrocher à une existence devenue indigne et se préoccupe d'envisager la suite.
Car votre question tend à déplacer un peu le problème. Certes la société, parce qu'elle se doit de gérer la masse, devra impérativement se doter de règles pour définir les limites de prise en charge de la grande dépendance. Mais elle doit avant tout travailler, en stimulant précisément le débat sur la prise de conscience et l'apaisement vis-à-vis de la mort, à favoriser le développement d'une démarche volontaire. La décision doit venir des personnes âgées elles-mêmes, pas de la société. La société ne doit que la rendre possible. Et si quelqu'un s'y refuse, ce sera son choix. Mais non cautionné par la société, donc sans assistance de celle-ci au-delà d'un certain seuil. Si une ou plusieurs personnes, que ce soient des descendants ou simplement des associations de gens aspirant à pratiquer bénévolement le dévouement, veulent prendre le relais, libre à eux. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais il ne peut y avoir d'obligation sociale sur ce point. La société pose ses règles et définit les limites de son action, chacun ensuite décide pour lui-même.
Il s'agit de promouvoir le droit à disposer de sa propre mort pour mourir dans la dignité. Et il s'agit d'inciter les gens à se mettre en paix avec la mort. Il ne s'agit pas d'exécutions programmées.
Quidam :
Heureuse précision ! Mais quand vous parlez du droit à disposer de sa propre mort, cela n'inclut-il pas le suicide ?
PG :
Absolument. Quelle est la différence entre suicide et euthanasie ? L'euthanasie n'est-elle pas qu'un suicide assisté ? Le suicide n'est-il pas simplement une auto- euthanasie ? Le vieillard amérindien qui part seul en forêt rencontrer sa mort, qu'elle prenne la forme d'un ours, d'un couguar, d'une chute dans un ravin ou d'un décès par inanition, se suicide-t-il ou s'euthanasie-t-il ? Ce n'est parfois ni l'un ni l'autre, mais le résultat est le même.
Quidam :
En effet, mais vous parliez d'euthanasie pour mettre un terme à une souffrance sans espoir, comme celle d'un malade incurable. Ce n'est pas le cas d'une personne qui se suicide.
PG :
Et qu'est donc un suicidé sinon quelqu'un qui est malade de la vie, et qui désespère au point de perdre espoir de renouer avec la joie ? La notion d'espoir est très personnelle et dépend complètement de la force intérieure que chacun a développée pour passer les coups durs de l'existence. Or je défends le droit à disposer de sa mort. Y compris pour d'apparentes mauvaises raisons, notion qui est hautement subjective.
La société est basée sur le conditionnement, essentiellement religieux à l'origine d'ailleurs, selon lequel le suicide, le refus de la vie, est l'acte le plus terrible qui soit. Les religieux vous assurent d'ailleurs généralement des pires supplices de l'enfer si vous osez commettre un tel sacrilège. Evidemment, dans une logique selon laquelle l'existence est un don divin, et qu'il faut se multiplier aveuglément sans se préoccuper de l'inconséquence qu'il y a à le faire sans limite dans un monde limité, se donner la mort va à l'encontre des valeurs communément admises. Et ça bouscule les bien- pensants. Ca leur renvoie aussi le fait que le monde qu'ils ont bâti n'est peut-être pas si réussi que ça puisque des gens renoncent à y vivre. Ca leur renvoie le fait qu'ils n'ont pas su aider cette personne à se construire, à développer la force intérieure nécessaire pour affronter les aléas de l'existence. Ca leur renvoie leur propre échec collectif. Cette culpabilité est particulièrement patente dans la famille d'un adolescent suicidé… Parfois aussi, cet acte du suicide met les gens face à leur propre tendance inavouée à vouloir faire de même.
Ceci dit, ne vous méprenez pas, je n'encourage pas au suicide. Pour avoir bien approfondi la question, je considère que ce n'est pas la meilleure des réponses aux défis de l'existence et qu'il y a toujours au moins une possibilité de remise en cause qui soit plus constructive.
Par contre, je dis que la société, si elle portait un regard plus ouvert sur la question pourrait gérer le problème différemment et avec moins d'effets collatéraux. Car s'apitoyer sur le suicidé n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le suicidé est parti. Pour lui, c'est réglé et son futur, en admettant qu'il y ait survivance post-mortem, n'est plus du ressort de la collectivité. Mais, il y a ceux qui restent. La mère qui, en allumant les phares de sa voiture dans le garage pour partir au travail de bon matin, découvre soudain devant elle le cadavre pendu de son fils. Le conducteur de TGV ou de métro qui voit un corps s'exploser sans prévenir sur son pare-brise. Les gens dont l'appartement perd un mur lorsque le suicide de la petite voisine par le gaz dégénère en explosion. Les promeneurs qui voient un corps s'écraser à côté d'eux au bas d'un immeuble, voire sur eux avec les dégâts qu'on imagine comme dans le cas de feu la maman d'Amélie Poulain. La femme qui trouve son mari baignant dans son sang dans la baignoire, les veines sectionnées. On peut citer ainsi de nombreux exemples où le mode de suicide engendre des traumatismes très profonds pour autrui, et qui vont bien au-delà de la simple douleur affective. C'est exactement le même principe que ces gens qui deviennent agoraphobes à compter du jour où une bombe explose à côté d'eux dans la rue. Cela crée des cicatrices émotionnelles souvent indélébiles. Certes ça donne du travail aux psychologues et contribue ainsi à la croissance du sacro-saint PIB. Mais question augmentation du niveau de bonheur, c'est le zéro pointé ! N'y a-t-il pas lieu de se préoccuper aussi de ça ? Car guérir est toujours difficile et incertain, se résumant souvent dans ce domaine à apprendre aux gens à vivre malades. Prévenir est donc de loin préférable.
Quidam :
Je vous suis mais ne vois pas à quoi vous voulez en venir.
PG :
Imaginez que la société se dote de structures de suicide assisté, ou disons, pour être plus soft, de fin de vie volontaire, dédiées à recevoir les désespérés et les accompagner dans leur passage à l'acte.
Quidam :
Attendez, vous allez loin là. On ne va pas s'inspirer de Soleil Vert pour modeler notre société.
PG :
Tiens, c'est juste, je ne pensais plus à ce vieux film. Mais rassurez-vous, je ne parle nullement de centrales de production secrètes de croquettes à base de chair de suicidé pour sustenter une surpopulation en malnutrition chronique, même si ce scénario n'est jamais qu'une extension au bétail humain de ce que nous faisons déjà aux animaux.
Non, je parle simplement d'une assistance au suicide pour sécuriser le passage à l'acte. Et pas simplement à destination des personnes suffisamment âgées pour souhaiter passer à autre chose, mais de toute personne en désamour profond avec la vie. Pour que ces gens puissent partir sans dégâts collatéraux pour ceux qui restent.
Et dans les dégâts collatéraux, on peut inclure le fait de se jeter discrètement dans la Garonne, laissant derrière soi un éternel doute quant à cette disparition inexpliquée. Victime d'un psychopathe ou de lui-même ? Ici, au moins, on saura. Et la famille pourra plus facilement ensuite faire son deuil en conséquence.
Quidam :
Ce sont plutôt les structures d'accompagnement psychologiques pour les dissuader de passer à l'acte qu'il faut développer.
PG :
En quoi est-ce incompatible ?
A quoi sert une structure d'écoute si les candidats au suicide, enfermés dans l'isolement de leur désespoir n'y font pas appel ? Du fait que le suicide soit aussi ouvertement réprouvé tant socialement que religieusement, combien de personnes portent en silence leur douleur existentielle, laissent croître leur désespoir sans en parler, jusqu'à ce qu'il devienne trop profond et qu'ils passent sans prévenir à l'acte ? Quand on n'a pas la force d'affronter l'existence, pourquoi faudrait-il avoir la force d'affronter un regard possiblement réprobateur ? Les réflexions stéréotypées, style « allons, faut se reprendre, tu te laisses aller », ou encore « c'est rien, tu déprimes un peu, ça va passer », sont-elles appropriées en pareils cas ? Combien de proches disent ensuite qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'il en arrive là ? Voire qu'ils n'avaient rien soupçonné du tout de son désarroi ? Et combien d'autres disent que le suicidé l'avait mentionné mais qu'ils n'avaient pas su quoi répondre ? Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir le sens de la psychologie pour trouver les mots justes en pareil cas. Et un diplôme ne le garantit certainement pas non plus.
Mais avec des structures dédiées à la fin de vie volontaire, probablement qu'il y aura davantage de chance de parler avec ces personnes, probablement que cet échange sera plus constructif, et probablement qu'un certain nombre d'entre elles, du fait de cette écoute préalable, en viendront à renoncer à cette extrémité. Et pour celles qui persisteront dans leur volonté, il leur sera proposé un moyen doux de passer à l'acte.
Quidam :
Vous risquez d'avoir du mal à recruter du personnel pour de tels centres. Pas tant pour la partie écoute psychologique que pour la partie mise à mort.
PG :
J'en doute fort. Au contraire même. Ce sera là un emploi bien plus noble que d'être dans une usine de fabrication de mines antipersonnelles ou autres engins de destruction, pour lesquels pourtant il n'y a aucun problème de recrutement. Toutefois, si c'est le cas, ce sera simplement signe que la démarche n'est pas comprise et qu'il faut l'expliquer davantage.
Et puis en accompagnant l'acte, il y a un aspect important qui doit être pris en compte également. Cet aspect est nié par l'optique matérialiste, à tel point que c'est à se demander comment la croyance en une existence limitée au corps physique peut donner un sens suffisant à la vie pour éviter de sombrer dans le désespoir. Mais comme la science ne permet pas d'écarter l'hypothèse spirituelle, pour ne pas dire qu'elle la confirme par ses lacunes, se préoccuper de préparer à l'après-mort fait également partie des aspects que la société peut considérer comme un service à proposer à ses membres. Je ne parle évidemment pas ici de qualité de pierre tombale ni de finesse des cendres, car je suis plutôt ulcéré de voir le business racket qui s'est développé aussi à ce niveau et auquel personne ne devrait être obligé de recourir, même si chacun doit pouvoir conserver la liberté de le faire si du superflu post-mortem a du sens pour lui. C'est bien d'accompagnement spirituel dont je vous parle. Quelle qu'en soit la forme religieuse.
Par exemple, dans notre société majoritairement, même si mollement, chrétienne, si l'on se base sur l'enseignement de Jésus que Mohammed a confirmé valable aussi pour les musulmans, il nous est dit : « il sera fait à chacun selon sa foi ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire sinon que la vie après la mort pourrait être considérablement influencée par ce que nous croyons au moment de notre décès ? De nombreuses traditions nous parlent de l'esprit créateur. Est-il alors déraisonnable de penser que celui qui croit qu'il ira brûler en enfer a de bonnes chances de vivre ça… un certain temps du moins, le temps pour son âme de se libérer de cette croyance et de passer à autre chose ? Tandis que celui qui se croit voué au paradis en goûtera peut-être les délices… au moins un certain temps. Alors, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute, n'est-ce pas un service à rendre à un individu que de favoriser le travail de conscience pour que l'éventuelle vie après la mort soit plus favorable ?
Quidam :
En admettant ce principe, qui n'est qu'une hypothèse avec laquelle je ne suis guère familier, je ne suis pas sûr de bien saisir les implications de la chose. Qu'est-ce que ça changerait dans le cas du suicide ?
PG :
Une personne qui en vient au suicide est généralement une personne qui, ne trouvant plus que le néant au fond de son cœur au lieu de « respirer la joie de vivre », et notez que cette expression n'est pas anodine, considère que tout est néant. Alors si telle est sa foi au moment de se suicider, l'après-mort qu'elle se prépare, sur la base de cette hypothèse, est plutôt de flotter dans le néant… du moins un certain temps. Essayez de vous imaginer flottant quelques siècles durant dans un néant absolu, et vous m'en direz des nouvelles. Pas franchement réjouissant comme perspective.
Si un accompagnement au moment du suicide favorise un échange préalable qui permet à la personne de positiver un minimum les choses avant de mourir, son après en sera radicalement transformé. Imaginez qu'au lieu d'une foi dans l'omniprésence du néant, vous en venez à admettre plutôt que le monde est plein de possibilités de joie, mais que, pour diverses raisons qui vous sont propres, vous ne souhaitez pas y poursuivre votre aventure, ou ne vous sentez pas la force de continuer à en affronter les aspects pénibles. Au lieu de glisser dans le néant, vous passez dans un autre monde, plein de possibilités, ce qui sera déjà une amélioration considérable. Au lieu de mourir avec la culpabilité de l'échec, vous partez avec l'amorce d'un pardon vis-à-vis de vous- mêmes. La plupart des religions proposent de prier pour accompagner les défunts dans leur voyage dans l'au-delà. Mais c'est faute de mieux. Et un accompagnement pré- mortem sera forcément préférable à des prières post-mortem. Même si l'un n'exclut pas l'autre.
Si on considère que le rôle de la société est de favoriser notre réalisation dans la vie, mais que la mort est le terme supposément inéluctable de cette existence, bien préparer à la mort n'est-il pas aussi une obligation pour la société dans son service à ses membres ?
Quidam :
Mais c'est demander à la société de prendre des responsabilités à caractère religieux, ce qui n'est pas compatible avec sa nécessaire neutralité, sa laïcité. Et de plus, ce serait prendre des positions sur la base d'hypothèses, tout étant affaire de foi dans ce domaine, faute de preuve scientifique.
PG :
Il est vrai. Mais je ne demande pas là à la société de remplacer les religions. Simplement d'en favoriser la place dans les sujets qui en relève. Ce n'est pas transgresser sa neutralité, et cela n'empêche en rien le matérialiste de continuer à croire que toutes ces bondieuseries sont de la foutaise. Et puis, si tant de gens sont tentés par le suicide, n'est-ce pas aussi en grande partie à cause de la faillite spirituelle régnant au sein de notre société ?
L'économiste Pareto a mis en avant le fait que, ceteris paribus, ce qui veut simplement dire « toute chose égale par ailleurs » mais le dire en latin ça en jette davantage, ceteris paribus donc, si une seule chose s'améliore, il y a globalement une amélioration. Logique, non ? Une chose est mieux, rien n'est moins bien, donc l'ensemble est un peu mieux. Comme quoi, de petites choses anodines peuvent suffire à laisser son nom dans l'histoire, sans nécessairement assassiner John Lennon… Dans notre cas, si avoir une vision plus positive de la mort permet de réduire l'appréhension de ce moment, et donc d'alléger ses craintes pour vivre plus sereinement, l'existence s'améliore. Ceux qui veulent continuer à refuser l'après-vie faute de preuve scientifique tangible, en ont le droit ; ils ont aussi tord et aussi raison que ceux qui veulent y croire faute de preuve scientifique du contraire. C'est affaire de foi. C'est personnel.
Donc si dans ce moment de désespoir profond, l'existence de structures de fin de vie volontaire permet de favoriser un échange pré-mortem pour au moins améliorer l'état d'esprit du suicidé au moment de son passage à l'acte, au pire ça ne change rien, au mieux le suicidé bénéficie d'un lancement plus porteur dans l'au-delà. C'est une amélioration au sens de Pareto.
Quidam :
Un raisonnement de Shadock en somme, mais effectivement, si ça ne fait pas de mal tout en pouvant faire du bien, ça se défend.
PG :
Au final, je gage qu'améliorer la perspective du futur contribuera aussi à améliorer la perspective du présent et que le nombre de désespérés confirmant leur désir de passer à l'acte en sera plus réduit. Et puis surtout, il y aura moins de dégâts collatéraux en cas de confirmation de la volonté de se suicider, ce qui est quand même l'un des objectifs de base d'une société fondée en grande partie pour répondre au besoin de sécurité des individus. Et alors là, même plus besoin des théorisations sur l'optimum de Pareto pour parler d'amélioration.
Mais au lieu de ça, et comme pour un certain nombre d'autres sujets d'ailleurs, la politique de l'autruche de la collectivité engendre davantage de problèmes alors qu'oser regarder la question en face apporterait au moins quelques solutions. Sous prétexte que la société considère que quelque chose est à décourager, voire à proscrire, elle relègue certains de ses membres à devoir recourir à des actes forcément accomplis dans de biens moins bonnes conditions et avec davantage de conséquences non maîtrisées. Et cela engendre davantage encore de problèmes.
Les bien-pensants sont bousculés par le voile islamique ? Qu'ils commencent par arrêter de se voiler la face !
Quidam :
Ce que vous dites me fait penser à la question de l'avortement.
PG :
Et à juste titre, car j'y pensais très fort aussi. Après une longue bataille morale, la France en est venue à l'autoriser. Mais avec un certains nombre de limites, notamment concernant l'âge du fœtus. Dès que quelqu'un se retrouve hors des clous, il est condamné à recourir à des actes clandestins et incertains. Heureusement, ces cas restent marginaux, la plupart des avortements pouvant être traitée dans le cadre légal normal.
C'est mieux que dans de nombreux autres pays de par le monde qui condamnent encore l'interruption volontaire de grossesse. Mais c'est moins bien que dans d'autres qui offrent des possibilités d'intervention plus larges, permettant ainsi à certains de nos concitoyens laissés hors des clous de notre législation restrictive de trouver quand même, mais ailleurs, un peu de l'aide qu'ils sont en droit d'espérer.
Quidam :
Inutile, dès lors, de vous demander si vous êtes pour l'avortement.
PG :
Il est bien clair que je suis totalement pour. Je ne souscris pas aux arguments étroits des prétendus « pro-vie », qui y voient un acte criminel. Pour moi, il est bien plus criminel d'imposer un enfant non désiré qui aura toutes les chances d'avoir une existence misérable, peut-être quasi irrémédiablement marqué sur le plan affectif si sa mère le rejette, peut-être sur le plan matériel du démarrage dans la vie si ses parents n'ont pas les moyens de l'assumer, ou peut-être encore du fait de malformations physiques détectées avant la naissance. Ces militants pro-vie se posent-ils simplement la question du droit au bonheur ? Si des parents décident sciemment d'accepter un enfant annoncé par exemple comme trisomique, il n'y a aucun problème. Mais si c'est pour le rejeter après la naissance, je n'y vois rien de désirable. Vivre avec un enfant handicapé profond qu'il vous faudra prendre en charge toute votre vie, ce qui modifiera considérablement votre existence, n'est pas une décision anodine. Avoir assez d'amour et d'abnégation pour le faire est remarquable et rare. Mais se dire « qu'importe, la société s'en occupera » est assez irresponsable.
De la même manière que l'immigration ne doit être autorisée que dans la limite où elle est intégrable, une naissance ne devrait avoir lieu qu'avec des perspectives d'offrir à ce nouvel être les conditions d'une existence constructive. La quête du bonheur et de son accomplissement est une démarche personnelle que rien ne peut garantir, mais un mauvais départ est clairement un handicap conséquent.
Quidam :
Quand même, n'avez-vous pas une optique un peu trop « jetable » de l'être humain ? N'est-ce pas paradoxal pour quelqu'un qui défend le respect de la vie ?
PG :
Si j'étais matérialiste, je vous répondrais : quoi d'autre ? Naître, grandir, travailler, vieillir, mourir… éphémère hasard biochimique sans lendemain, ainsi que je le disais tout à l'heure. Un humain après l'autre dans un long déroulé du temps, en attendant que l'espèce ne s'autodétruise, ainsi qu'elle semble bien partie pour le faire, rectifiant ainsi par elle-même cet accident biochimique qui lui donna naissance. N'est-ce pas alors effectivement la nature de l'humain que d'être jetable ?
Mais je ne suis pas matérialiste. Je crois que l'existence terrestre est une école pour s'améliorer. Et je crois à la poursuite du voyage après la mort physique. Dès lors, le corps peut être jetable. Mais le jeter inutilement relève du gaspillage. Et je n'aime pas le gaspillage. Dans une optique d'évolution, de développement de conscience et donc de respect de la vie, l'être humain se doit aussi de respecter son propre corps. Mais respecter. Non s'y accrocher.
Souvenez-vous de ce point capital : le but de la vie est de vivre, non de ne pas mourir.